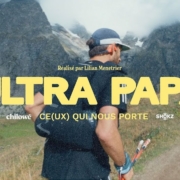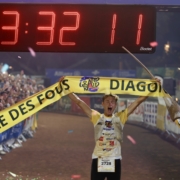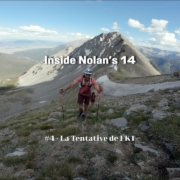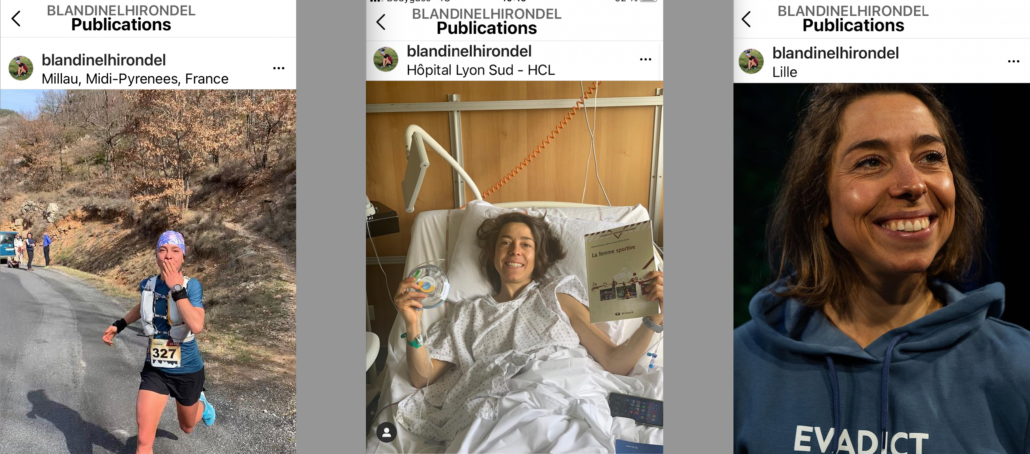À l’heure où les ultra-trails sont de plus en plus médiatisés, et leurs acteurs hissés au rang d’icônes, nous vous proposons une plongée dans l’histoire des courses d’endurance. Vous découvrirez que ce phénomène n’est pas nouveau, et qu’il a même été bien plus important par le passé.
La chasse, première course d’endurance de la Préhistoire
Bien qu’il n’existe aucune preuve scientifique l’attestant formellement, l’évolution de l’homme laisse penser qu’il est né pour courir. La chasse à l’épuisement est une théorie dans l’évolution des homininés. Elle nécessite des qualités d’endurance pour la course de fond. Lassé de manger des fruits et des baies, l’homme serait un jour descendu de son arbre pour courir après les proies des grandes plaines d’Afrique ou des forêts européennes. Il s’avère alors être doué pour l’endurance, grâce entre autres à ses longues jambes et à un système de transpiration par la peau qui lui permet de tenir la distance. Ce système de refroidissement est la clé de la chasse à l’épuisement qui permet à l’homme de venir à bout de proies agiles et bonnes sprinteuses mais qui, pour se refroidir, doivent s’arrêter et haleter, avant de pouvoir repartir. Notamment utilisée par le passé par les peuples Bochimans du désert du Kalahari (ou peuple San) ou les Tarahumaras, cette chasse à l’épuisement se pratiquait par grosse chaleur, afin que les proies se fatiguent plus rapidement.

Un 100K dans l’Égypte antique
Le phénomène trail dans sa version compétition a déjà quelques centaines d’années dans les jambes. Au VIIe siècle avant Jésus-Christ déjà, dans l’Égypte antique, la XXVe dynastie pharaonique propose lors de ses jeux une course de 100 km entre Memphis et l’oasis du Fayoum. Les adorateurs du dieu Amon de Napata confrontent leurs aptitudes à la course pendant près de 8 heures. Il ne s’agit vraisemblablement pas de compétition, mais plutôt de loisir, sans autre récompense à la clé que le plaisir de courir et d’aller au bout de la performance.
Quand trail rimait avec travail
Pour les coursiers des armées grecques en revanche, la course à pied était un travail. Ainsi Philippidès, messager qui aurait couru de la ville de Marathon jusqu’à Athènes, distante d’environ 42 km, pour annoncer la victoire contre les Perses à l’issue de la bataille de Marathon lors de la Première Guerre médique en 490 avant J.-C., n’avait fait que son job. On retrouve bien plus tard ce phénomène des valets-coursiers dans les riches familles anglaises. Eux aussi parcourent de longues distances pour porter leurs messages, peu avant que la révolution industrielle et son lot de moteurs à explosion ne les mettent au chômage. Quant à l’organisation de la première compétition à proprement parler, on l’attribue au roi écossais Malcolm III au XIe siècle, alors qu’il est en quête d’un coursier. Celui qui remportera la course vers le sommet d’une montagne de la région, se verra attribuer sa récompense : un emploi.

L’avénement des Pedestrians
Walter Thom, journaliste né en Écosse au XVIIIe siècle, situe les premiers exploits de coureurs de fond à partir de 1762. Cette année-là, un jeune homme de Wandsworth, au sud de Londres, court 70 km en 7 heures 57. La même année, un certain John Hague parcourt 160 km en 23 heures 15. C’est le début des compétitions appelées « matches » entre les marcheurs / coureurs de fond les plus aguerris, le tout sur fond de paris juteux. Les athlètes, que l’on appelle à l’époque les « pedestrians », touchent une partie de la recette. L’engouement pour ces « matches » est tel que les compétitions commencent à foisonner.
Les stades font le plein !
Aux États-Unis et en Angleterre, les passionnés de la discipline se rendent massivement dans des stades pour suivre les exploits. En 1875, dans le New Jersey, est même organisée la première d’une longue série de « courses de 6 jours » : les concurrents tournent sur une piste de 200 mètres pendant 144 heures d’affilée, le tout dans une ambiance bruyante et enfumée. En 1880, la course est même la discipline sportive la plus suivie du pays, déchaînant les passions et faisant s’envoler les montants des paris, avant que la législation ne vienne l’interdire, estimant qu’elle ne respecte pas le bien-être des participants.

Foster Powel, chapeau l’athlète !
Parmi les grandes vedettes de l’ultra-endurance de l’époque, Foster Powell a un parcours atypique. Né en 1734 au nord de l’Angleterre, le jeune Foster ne fait pas sensation dans son village. On le décrit comme un garçon banal, discret et plutôt asocial. La seule chose remarquable chez lui est son endurance. C’est cette aptitude exceptionnelle qui fera de l’homme ordinaire une star. Alors qu’il travaille à Londres comme notaire, ses collègues se moquent sans cesse de ses manières. Un jour, alors qu’ils s’enquièrent de ce que ce dandy timide prévoit pour le samedi suivant, il répond qu’il compte faire l’aller-retour à pied jusqu’à Windsor, soit près de 80 km, ce qui provoque la moquerie générale. Vexé, Powell les met au défi de l’accompagner. Deux d’entre eux acceptent ; le premier le suivra pendant 10 km, le second 20 avant d’abandonner à son tour. Ceux-là mêmes qui le raillaient font alors la promotion de son exploit, et il rejoint rapidement le cercle des pedestrians les plus célèbres du XVIIIe siècle.
Déjà une certaine science de l’endurance
L’homme longiligne aux mollets robustes, toujours élégamment – quoique lourdement – vêtu, est reconnaissable à son chapeau qui ne le quitte jamais. Mais si sa tenue est loin d’être idéale pour la pratique sportive, ses habitudes démontrent déjà une certaine science de l’endurance. Ainsi, lors de ses parcours, jamais il ne mange pas de viande et chacune de ses pauses rafraîchissement est savamment planifiée. Sur son parcours favori, Londres-York aller-retour, soit près de 650 km, il réalisa à l’âge de 58 ans un temps record de 5 jours, 15 heures et 15 minutes. Contrairement à d’autres pedestrians de son époque, Powell mourra dans le dénuement le plus total.

Barclay, père de la marche rapide
Quelques années plus tard, c’est un Écossais qui fait sensation. Né en 1 779, Robert Barclay Allardice est considéré comme le père de la marche rapide. Celui que l’on surnomme le “Celebrated Pedestrian”, passionné d’outdoor et incapable de rester enfermé, se démarque par ses capacités exceptionnelles en tant que marcheur à l’âge de 17 ans, en remportant son premier pari sportif : 10 km en marche rapide (un pied toujours en contact avec le sol) en 1 heure. Si ses compétences n’étonnent pas ceux qui le connaissent déjà, le montant du gain, 100 guinées, une somme rondelette, est en revanche surprenant. Barclay apprend donc très tôt que ses capacités hors normes peuvent lui rapporter beaucoup à une époque où les paris sportifs et les jeux d’argent sont plus qu’à la mode.
41 marathons d’affilée !
Parmi les exploits de Barclay, en 1801, il parcourt 177 km en 19 h 27. Puis, en 1806, 161 km en 19 heures sur des routes accidentées. En 1809, en Angleterre, la foule se presse à Newmarket aux côtés de grands lords de l’époque, non pas pour assister aux courses de chevaux habituelles, mais pour apercevoir l’homme de presque 30 ans qui vient de parcourir en marchant 1 000 miles (1 600 km) en 1 000 heures, soit quasiment un marathon par jour pendant 41 jours d’affilée. Durant son exploit, il aura perdu 14 kg mais aura fait monter la somme des paris à près de 5 millions de livres sterling, une véritable fortune pour l’époque. Ce sera sa performance la plus suivie, près de 10 000 personnes l’acclamant tout au long de son trajet. Cinq jours après son exploit, Robert Barclay est réquisitionné par l’armée et prend alors le nom de Captain Barclay. Devenu l’un des pedestrians les plus riches de son époque, il s’engagera ensuite dans le milieu de la boxe en tant que coach, et décédera en 1854 des suites d’une blessure causée par… un coup de sabot de cheval.

Mensen, le Norvégien le plus riche du monde
Parmi les pedestrians grassement rémunérés pour leur endurance, Ernst Mensen, surnommé « le Norvégien le plus riche du monde », était connu pour ses exploits invraisemblables. Né en 1795, Mons Mensen Oyri, alias Ernst Mensen, est le septième fils d’une famille modeste. Sa carrière débute dans la marine marchande britannique. Bien qu’il ait le pied marin, c’est sur la terre ferme qu’il s’illustre en remportant une course en Afrique du Sud. Cette victoire marque un tournant dans sa carrière. Il part alors pour l’Angleterre, où les courses d’endurance connaissent leurs heures de gloire, et devient un des premiers traileurs professionnels. Il devient riche, richissime même et enchaîne les voyages avec de nombreux arrêts à Paris, où il mène la grande vie. Les routes n’étant pas sûres à l’époque, Mensen faisait toutes ses courses équipé d’une arme.
Un ultra-exploit qui change tout
En 1832, Mensen se lance un défi qui va changer la face de la discipline et surpasser de loin les exploits de ses prédécesseurs : le Paris-Moscou. Équipé d’une boussole et se fiant aux étoiles, il parcourt les 2 500 km qui séparent les deux capitales en 14 jours, à raison de 180 km par jour en moyenne. S’il n’y avait pas eu de témoins, personne n’aurait cru cela possible. Encore plus audacieux, Mensen remet ça entre Constantinople et Calcutta, soit 7 000 km en 59 jours à raison de 140 km par jour, trouvant gîte et couvert chaque soir sur son trajet. La presse de l’époque rapporte qu’il mange toujours froid et dort peu. Depuis trop longtemps déraciné, il ne retournera jamais dans son pays natal. Il n’ira pas non plus au bout de son dernier voyage, un défi au départ de Paris pour trouver la source du Nil. Il mourra pendant l’expédition, près de la frontière entre l’Égypte et le Soudan.