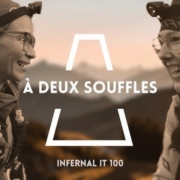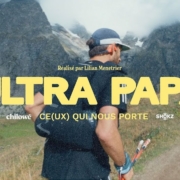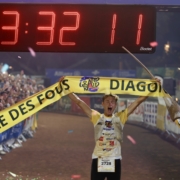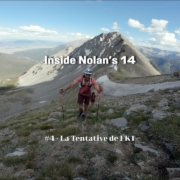Pour beaucoup d’entre nous, le début de l’hiver marque la fin des sorties trail. Mais pas question de ranger les baskets et de perdre le bénéfice de tous les entraînements de fin de saison. Le tapis de course reste une alternative intéressant. On vous explique pourquoi, et comment optimiser vos séances sur tapis de course.
Contrairement aux idées reçues, l’entraînement en salle ne se résume pas à un simple plan B pour faire face aux rigueurs de la météo. On peut très bien concevoir des séances bénéfiques pour le coureur. Le tapis permet par exemple de maintenir une régularité du rythme en limitant les fluctuations d’allure. Sur une piste, une route ou un chemin, le coureur a tendance à adapter sa vitesse en fonction de ses sensations et de la distance. Le tapis, lui, vous oblige au contraire à tenir la bonne allure, autant sur le plan physique que mental.
Pour certaines séances de seuil ou de fractionné long (type 4 x 2 000 m), le tapis peut alors se substituer avantageusement à la séance en extérieur. Bien évidemment, il ne pourra jamais remplacer les conditions réelles, et si l’un des objectifs de l’entraînement est de préparer le coureur à affronter les conditions de course rencontrées en compétition, ce n’est pas compatible avec un entraînement en salle. L’entraînement sur tapis va surtout vous permettre de limiter les désagréments de la course en hiver. Ainsi, pour la récupération, ou pour certaines séances spécifiques, il est particulièrement indiqué.
Lire aussi notre article Comment reconnaître un bon tapis de course

Le tapis de course, un outil supplémentaire pour le coureur
La programmation des séances est l’un des gros avantages du tapis. Grâce aux fonctions assez élaborées de certaines machines, on peut facilement construire des entraînements relativement précis. Vous contrôlez toujours les principaux paramètres de course : vitesse, dénivelé, distance. En outre, le tapis de course est généralement un engin assez facile à maîtriser. Une petite dizaine de minutes suffit pour trouver son équilibre et un placement optimal, ni trop devant ni trop en arrière. Attention de ne pas avancer plus vite que la bande de roulement, vous risquez de taper dans l’avant de la machine et d’être déséquilibré.
Autre avantage non négligeable, vous évitez la galère des séances urbaines en pleine nuit et dans le froid (circulation, météo, insécurité). Vous pourrez aussi vous hydrater plus facilement. Et la douche n’est jamais très loin, ce qui est toujours intéressant dans des salles généralement surchauffées. En outre, la salle de gym peut aussi être l’occasion de profiter des autres outils de musculation et de faire un travail de renforcement spécifique.
Tapis de course : la théorie du 1%
En extérieur, vous courez toujours contre un adversaire invisible : la résistance à l’air. Plus vous allez vite, plus cette résistance augmente, vous obligeant du même coup à fournir un effort encore plus important. A contrario, à l’intérieur, vous n’avez pas à affronter ce vent relatif.
Une étude britannique menée il y a près de 20 ans par des chercheurs de l’université de Brighton avait ainsi démontré que les athlètes qui s’entraînaient à l’extérieur et qui étaient obligés de lutter contre la résistance de l’air dépensaient plus d’énergie que ceux qui s’entraînaient en salle, sur tapis, et ce quel que soit le rythme. « Plus vite vous courez, plus important sera l’effet subit », expliquait alors Jonathan Doust, un des médecins coauteurs de l’étude. À des vitesses moindres, la résistance à l’air est certes moins forte, mais elle existe toujours.
Ainsi, selon cette étude, une course en extérieur à 5km/h va demander 5% d’énergie en plus. Soit quelques battements supplémentaires. Mais suffisamment pour accroître la fatigue. Jusqu’à une certaine allure, environ 12 km/h, la différence est imperceptible. Il n’est donc pas nécessaire d’augmenter l’inclinaison du tapis. Entre 12 et 18 km/h, il faut augmenter l’inclinaison du tapis de 1 %. À des vitesses encore plus élevées, il faudra encore augmenter le pourcentage de la pente (2 %) pour compenser l’absence de résistance à l’air.

Les limites du tapis de course
Attendez-vous à transpirer un peu plus, car en intérieur vous n’aurez pas à subir l’effet du vent. L’air permet d’évacuer la transpiration et de rafraîchir l’organisme pendant l’effort. En salle, vous n’aurez pas de vent, par conséquent la dépense énergétique sera plus importante. À effort identique, la fréquence cardiaque sera aussi plus élevée, car l’organisme devra fournir un effort supplémentaire pour réguler la température corporelle.
Au niveau musculaire, les appuis ne sont pas non plus les mêmes. La foulée est ainsi modifiée, vous devrez ramener le pied plus rapidement sur le tapis pour suivre le roulement de la bande. Conséquence : une phase de propulsion moins importante et un travail musculaire sensiblement différent. Le nombre de foulées est plus important.
Pour finir, le tapis ne permet pas de réaliser tous les entraînements, et à la longue la bande roulante du tapis peut être finalement plus traumatisante que les chemins en sous-bois. Ainsi, les risques de traumatismes articulaires peuvent être accrus en cas d’utilisation trop importante.
Au niveau mental enfin, la perception de l’effort est différente. Courir une heure sur un tapis face à une glace ou à un mur, et même avec des écouteurs dans les oreilles, devient vite lassant malgré toute la motivation du monde.
Lire aussi notre article Débutant, avancé et expert : 3 séances sur tapis de course

3 « bonnes » séances sur tapis de course
Voici quelques exemples pour bien utiliser le tapis de course. Planifiez au maximum deux entraînements par semaine sur tapis en alternant ces différentes séances. Veillez à conserver la majeure partie de votre entraînement en extérieur, pour un total de 3 à 5 entraînements hebdomadaires (hors préparation spécifique).
1 – SÉANCE DE RÉCUPÉRATION
Programmez de 35 à 45 minutes d’endurance sur tapis. Vous pouvez soit utiliser comme repère votre fréquence cardiaque ou bien la vitesse du tapis si vous connaissez votre allure en endurance.
2 – CÔTES SUR TAPIS
Échauffement en endurance durant 20 minutes. Programmation de la vitesse du tapis : « ALLURE MARATHON ».
2 minutes à allure marathon. Inclinaison 1 %.
1 minute à allure marathon.
2 minutes à allure marathon. Inclinaison 2 %.
1 minute à allure marathon.
3 minutes à allure marathon. Inclinaison 3 %.
Augmentez progressivement la difficulté sur 8 semaines, jusqu’à atteindre de 6 % à 7 % d’inclinaison.
Retour au calme : 20 minutes en endurance.
3 – SÉANCE AU SEUIL
Échauffement en endurance : 20 minutes.
Programmation de la vitesse du tapis : allure sur 10 km-15 minutes (exemple : 4 minutes/ km sur 10 km donne 3 minutes 45 sur tapis).
Séance : 1 x 5 minutes + récup 2 minutes + 1 x 8 minutes + récup 3 minutes + 1 x 5 minutes + récup 2 minutes.
Retour au calme : 10 minutes en endurance.