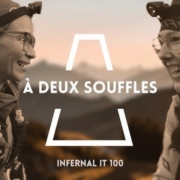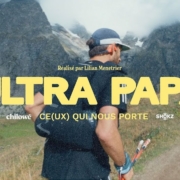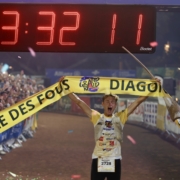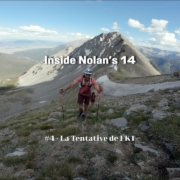Atteindre rapidement votre potentiel maximum ! Si tel est votre but, le travail de fractionné sera votre meilleur allié, même en trail. Et pour rompre la monotonie des séries, les séances pyramidales seront idéales ! Explications des coachs d’Esprit Trail.
Qu’est-ce qu’une séance pyramidale ?
Une séance pyramidale est une séquence d’entraînement par intervalles (succession de phases de course plus ou moins rapide, entrecoupées de phases de récupération) qui augmentent progressivement puis diminuent de façon à réaliser une pyramide. Ce type de séance très ludique ajoute de la variété par rapport aux séances de fractionné consistant en x répétitions de la même distance ou durée.
En plus de casser la monotonie, le fractionné en pyramide va vous apprendre à mieux connaître vos allures de Vitesse Maximale Aérobie (sur une pyramide évoluant de 95 à 105% de VMA) et de compétition (sur une pyramide à allure spécifique). Il va aussi éviter l’accoutumance qui se produit lorsqu’on réalise toujours le même type d’effort, et qui limite la progression.
Psychologiquement, ce type de séance est également très intéressant parce qu’on commence et on finit par les fractions les plus courtes, et qu’entre les deux l’augmentation est progressive. Ainsi, on a moins peur de souffrir et quand on a atteint le sommet (la distance ou la durée la plus longue à effectuer). Et on sait que la suite sera de moins en moins difficile. Ce qui est très motivant, reconnaissez-le…

Fractionné en pyramide : des séances très « sollicitantes »
Au niveau rythme, on peut démarrer et finir relativement vite puisque les durées sont plus courtes au début et à la fin. C’est très agréable, grâce aux sensations de dynamisme que cela procure. Un principe à respecter cependant : ne pas « tout donner » dans la phase montante, afin d’en garder un peu sous le pied pour pouvoir courir légèrement plus vite durant la phase descendante. Le fait de devoir se concentrer sur la durée de l’effort à venir permet aussi d’être totalement dans l’action.
Attention, il ne s’agit pas de dire ici que ce type de séance est la panacée et qu’il faut réaliser tous ses fractionnés de cette manière. En effet, ces séances ont tendance à fortement solliciter l’organisme et il est préférable de les intercaler entre des séances de fractionné classiques et plus courtes. Il est aussi très important de prévoir deux jours de récupération (sans fractionné) après chaque séance de fractionné. Vous ferez ainsi jouer au maximum les mécanismes de surcompensation, vecteurs de votre progression, et éviterez les blessures.

Fractionné en pyramide : idéal pour le traileur
Hormis les débutants complets qui auront avantage à démarrer le fractionné sur des durées courtes et égales leur permettant de trouver plus facilement le bon rythme, les pyramides pourront s’adapter et être bénéfiques à tous les traileurs. Grâce aux variations d’allure qu’elles imposent au fur et à mesure que les durées s’accroissent puis se réduisent, elles permettent de maîtriser différents rythmes et d’apprendre à mieux contrôler l’intensité de son effort.
Selon son niveau et son objectif, on peut bien sûr varier à l’infini en effectuant des séances et des portions plus ou moins longues. La pyramide peut parfaitement s’intégrer jusque dans une préparation de kilomètre vertical (pyramide en côtes raides avec des récupérations en continuant à monter) ou de trail long en augmentant les durées.
Si on veut aller jusqu’au bout de la variété, on peut aussi se concocter des pyramides spécifiques. Citons entre autres :
– les pyramides asymétriques : augmentation très progressive des durées, puis diminution très rapide, ou l’inverse ;
– les pyramides uniquement montantes (on augmente les durées et on termine par la plus longue) et uniquement descendantes (on commence par la plus longue durée que l’on raccourcit au fil des répétitions pour terminer par la plus courte).

Fractionné en pyramide : quelques exemples de séances nature trail
1/ La pyramide à VMA
(allure que l’on tient aux alentours de 6mn)
Du fait que cette séance est exprimée en « durées » et non pas en « distances », elle a l’avantage de pouvoir être réalisée en pleine nature. Choisissez toutefois un sol peu technique afin que ce ne soit pas lui votre facteur limitant. A noter qu’il s’agit d’une pyramide à sommet plat puisque la distance la plus longue est à répéter après 2mn de récupération.
Après 20mn d’échauffement, les fractions suivantes sont à effectuer aux alentours de 100% de VMA, de 105% pour les 30s à 95% pour les 1mn30 :
(R’ : temps de récup en trottinant)
30s – R’ 30s – 45s – R’ 45s – 1mn – R’ 1mn – 1mn15s – R’ 1mn15s – 1mn30s – R’ 2mn – 1mn30s – R’ 1mn30 – 1mn15s – R’ 1mn15s – 1mn – R’ 1mn – 45s – R’ 45s – 30s.
10mn de retour au calme
Temps total de fractionné : 10mn
2/ La pyramide au seuil
(allure que l’on tient aux alentours d’une heure)
Pour un objectif trail, cette séance sera elle aussi réalisée en nature. Si vous souhaitez en même temps travailler votre aisance en tout-terrain, le sol pourra être plus technique que pour la séance précédente vu qu’elle sera courue à « seulement » plus ou moins 85% de VMA selon les durées. A noter qu’il s’agit d’une pyramide à sommet pointu puisque la distance la plus longue n’est courue qu’une seule fois.
Après 20mn d’échauffement, voici les fractions que vous pouvez effectuer :
(R’ : temps de récup en trottinant)
3mn – R’ 1mn30s – 4mn – R’ 2mn – 5mn – R’ 2mn30s – 6mn – R’ 3mn – 5mn – R’ 2mn30 – 4mn – R’ 2mn – 3mn.
10mn de retour au calme à 65-70% VMA
Temps total de fractionné : 30mn

3/ La pyramide sur côte courte
Même les séances de côtes pourront être programmées avec une progressivité des durées. Choisissez une montée en nature, de préférence sur terrain souple, où vous pourrez totaliser 1mn30 de course rapide continue.
Après 20mn d’échauffement à 65-70%VMA, voici les temps d’effort en côte que vous pouvez effectuer (augmentation puis retrait de chaque fois 10s – toutes les récupérations se font en redescendant en trottinant à votre point de départ) :
30s, 40s, 50s, 1mn, 1mn10s, 1mn20s, 1mn30s, 1mn20s, 1mn10s, 1mn, 50s, 40s, 30s.
10mn de retour au calme
Temps total de fractionné : 12mn30
4/ La pyramide sur côte longue
Pour cette séance, vous aurez besoin d’une côte beaucoup plus longue, puisque les temps de récupération, même s’ils se feront en descente, seront moins longs que les temps d’effort et ne vous permettront pas de retourner jusqu’à votre point de départ. Si vous souhaitez en même temps travailler votre aisance en tout-terrain, le sol pourra être plus technique que pour la séance précédente, vu qu’elle sera courue moins vite.
Après 20mn d’échauffement à 65-70%VMA, voici les temps d’effort en côte que vous pouvez effectuer :
(R’ : temps de récup en trottinant)
2mn – R’ 1mn – 3mn – R’ 1mn30s – 4mn – R’ 2mn – 5mn – R’ 2mn30s – 6mn –R’ 3mn – 5mn – R’ 2mn30 – 4mn – R’ 2mn – 3mn – R’ 1mn30 – 2mn.
10mn de retour au calme.
Temps total de fractionné : 34mn
Cet article est paru dans le magazine Esprit Trail Hors-Série Entraînement 2022.
Pour commander le magazine complet en version papier ou digitale, c’est ICI